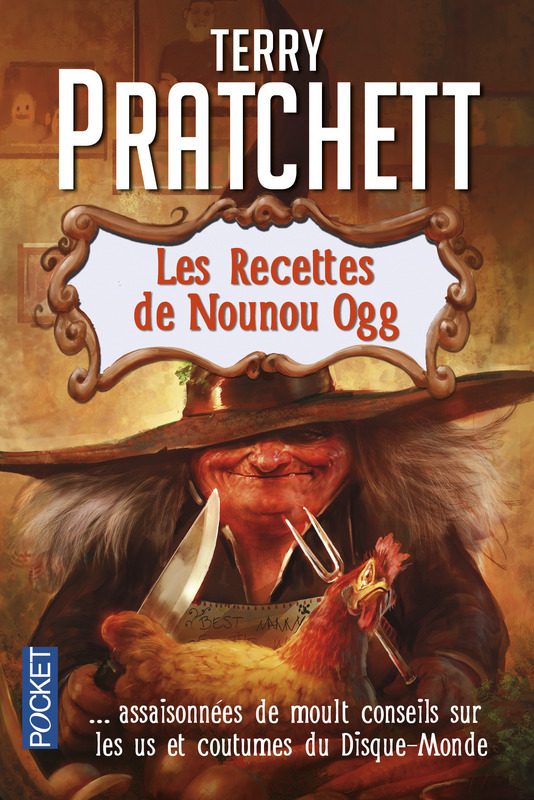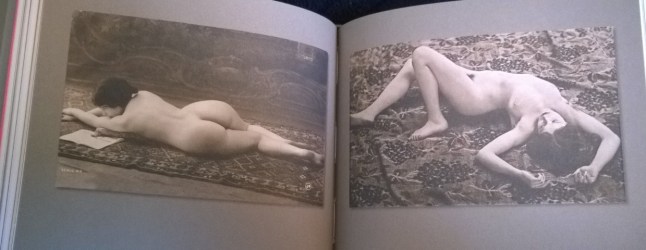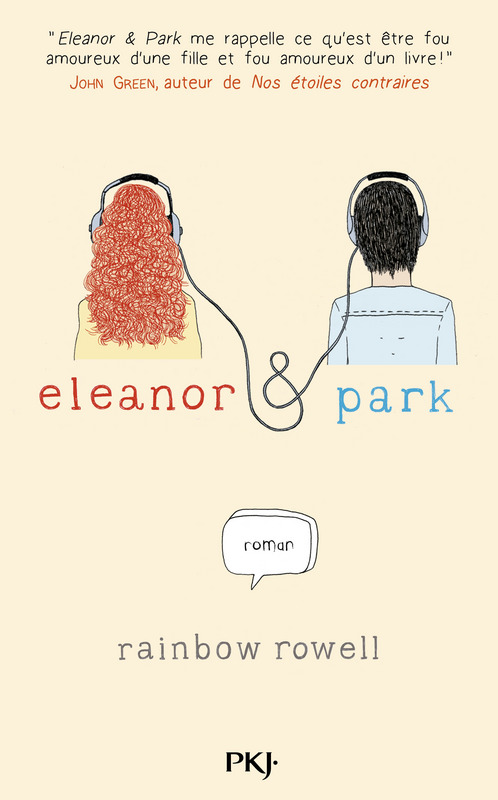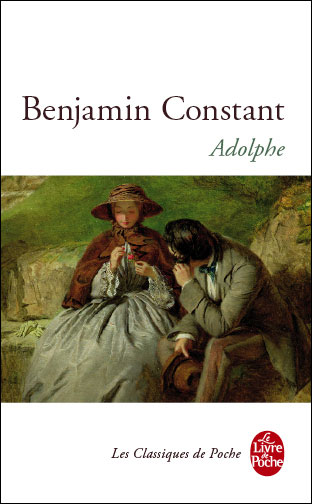Dans ce recueil de recettes un peu particulier, la célèbre sorcière Nounou Ogg nous livre ses secrets pour réaliser les plus fameuses spécialités culinaires (ou presque) de tout le Disque-Monde… à nos risques et périls !
L’annonce, en mars dernier, de la mort de Terry Pratchett, m’a causé un petit coup au coeur… Depuis dix ans déjà, ses Annales du Disque-Monde me réjouissaient, et c’est avec lui que j’ai osé mettre un pied dans la fantasy, certes un peu (beaucoup) loufoque.
Si Terry Pratchett, qui se savait atteint de la maladie d’Alzheimer, avait milité dans les médias pour le droit de mourir dans la dignité, et que ses lecteurs étaient donc en quelque sorte prévenus de l’issue qui se profilait, il n’en reste pas moins que la nouvelle de sa mort a bouleversé de nombreux fans. Mon premier réflexe a été de me précipiter dans ma librairie fétiche pour acheter quelque chose de lui : j’en suis ressortie avec Les Recettes de Nounou Ogg, mais toujours aussi triste.
il aura fallu attendre novembre pour que l’amie Emma et moi fassions un sort à cet ouvrage : c’est enfin chose faite !
Le livre s’ouvre sur une dispute, par notes interposées, entre les éditeurs ayant eu les recettes entre les mains avant publication : ils s’inquiètent du fait de livrer au public des recettes dangereuses ou sujettes à interprétations pour les esprits les plus mal tournés, connaissant déjà de quoi Nounou est capable !
Vous vous souvenez de ce qui s’est passé après que nous avons imprimé Les Plaisirs de la chère ? Je n’ai plus jamais regardé les flans de la même façon. Mon épouse glousse dès qu’on parle de crème, ce qui, je vous l’assure, est assez déconcertant après trente ans de mariage.
Nounou Ogg se fend elle-même d’une préface dans laquelle, rappelant que les sorcières sont « les suppositoires de la tradition », elle explique l’intérêt de perpétuer recettes ancestrales et art de recevoir.
Si vous donnez un dîner, que dit la bienséance de faire asseoir un homme qui gagne sa vie en glissant des belettes dans son pantalon pendant les foires, et qui y est donc fort respecté, à côté de la fille d’un homme qui a autrefois dépouillé le fils puîné d’un marquis ?
Dans un manuel qui ferait pâlir d’envie Nadine de Rotschild, Nounou Ogg détaille les convenances à respecter lors d’occasions précises (fiançailles, mariage, enterrement…) et les manières les plus élégantes de déguster les mets compliqués.
Les artichauts : l’aliment amaigrissant parfait, puisque les éplucher et les manger requiert plus de calories qu’ils n’en contiennent. Arrachez chaque feuille individuellement, trempez la partie charnue dans la sauce, et raclez-la avec les dents. Reposez la partie restante en tas sur le bord de votre assiette, quoiqu’il soit permis de la jeter dans l’abat-jour. Les artichauts ont été inventés parce que les riches n’avaient pas assez de choses à faire de leur temps.
Si jamais, après avoir été prévenus maintes et maintes fois, vous envisagiez quand même, comme Emma, de réaliser l’une ou l’autre des recettes du livre, dites-vous bien que la version qui vous en est livrée a été retouchée par Nounou Ogg pour être rendue comestible ! Ouf. Voyez ce qu’elle nous dit par exemple des sablés de voyage.
La version originale est en fait la variété humaine du pain de nain, ce qui revient à dire qu’il vous maintient en vie mais vous fait regretter de ne pas être mort, et se conserve particulièrement bien parce que personne ne veut le manger. Je l’ai améliorée un peu, afin de la rendre un peu attractive aux yeux de gens qui ne sont pas naufragés sur un canot quelque part et n’ont pas déjà mangé leurs vêtements et le plus faible des survivants.
Ce livre de recettes est donc un moyen amusant de croiser les personnages emblématiques des Annales, et se révèle surtout être un moyen idéal pour ne pas dire au revoir à Terry Pratchett. Nul doute que les tomes qu’il me reste à lire trouveront leur place ici !